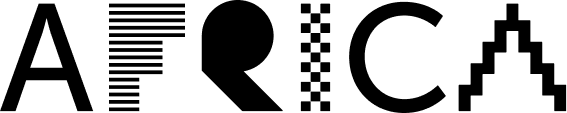Financer L'Afrique que Nous Voulons : souveraineté, autonomie, responsabilité
25 July, 2025
Cet article est l’avant-propos du rapport du Forum Ibrahim 2025, Financer l’Afrique que Nous Voulons.
L’Ibrahim Governance Week-end 2025 (1-3 juin 2025, Marrakech, Maroc) s’est tenu à un moment critique. Il est impossible d'échapper au bouleversement profond des équilibres géopolitiques et à l’ampleur des défis à relever. À cinq ans de l'échéance fixée par les Nations Unies pour la réalisation des Objectifs de Développement Durables, l'Afrique est loin du compte, avec seulement 6 % en moyenne des objectifs atteints à ce jour. Certes, lorsque les ODD ont été définis, ni la COVID-19, ni la généralisation des catastrophes climatiques, ni la guerre en Ukraine, ni l'escalade du conflit israélo-palestinien ne figuraient sur la carte ou à l'ordre du jour.
Les priorités ont changé et 2025 n'est qu’un clou final sur le cercueil de l'aide au développement. Au cours de la décennie écoulée, les budgets d’aide au développement ont fondu avec les effets combinés de la montée de l'isolationnisme, de la reprise des conflits internationaux et de l'affaissement de l'économie mondiale. La plupart des bailleurs historiques ont désormais réduit à l’os les budgets d’aide au développement. En outre, la réforme en cours du système multilatéral, fondé et financé par les pays développés il y a 80 ans pour « aider » les pays en développement à gérer pauvreté et conflits, ne répond pas aux attentes, les engagements financiers étant de moins en moins respectés et de faible impact, alimentant une défiance croissante.
L’aide étrangère a été importante pour les pays africains et les coupes drastiques récentes impacteront dramatiquement des secteurs essentiels tels que la santé ou l’appui aux sociétés civiles. Mais la fin de l'aide traditionnelle n'est ni inattendue, ni la fin du monde pour notre continent. Elle ne représentait déjà qu'un faible pourcentage du revenu des pays africains - moins de 10 % en moyenne. Pour 42 d'entre eux (sur 54), les dernières coupes de l'USAID représentent moins de 1 % de leur revenu national brut.
Fixé par l'Union africaine il y a plus de dix ans, l'Agenda 2063 – L'Afrique Que Nous Voulons – n’a pas défini la vision à 50 ans d'un continent toujours dépendant de l'aide, mais bien au contraire celle d'une puissance mondiale traçant sa propre voie. C'est bien à nous, Africains, et non à un quelconque partenaire, qu'il incombe de concrétiser cette vision. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons des ressources nécessaires pour le faire. Les francs débats qui se sont déroulés pendant trois jours à Marrakech ont mis en évidence cette réalité, mais aussi la nécessité d'un changement de paradigme si nous voulons faire de ce potentiel une réalité.
Premièrement, les ressources financières domestiques peuvent être mieux exploitées. Il faut assécher les flux financiers illicites qui continuent à faire sortir du continent des montants supérieurs à ceux de l'APD reçue, gérer une dette extérieure qui atteint désormais le niveau inacceptable d'un quart du PIB du continent, renforcer les systèmes fiscaux domestiques, réorienter les fonds souverains et les fonds de pension africains vers des investissements sur le continent et faire meilleur usage des envois de fonds des travailleurs émigrés.
Deuxièmement, les ressources naturelles de notre continent doivent être efficacement monétisées, afin de bénéficier en priorité à nos propres concitoyens. Le patrimoine de l’Afrique est bien documenté ; le continent abrite 30 % des réserves minérales mondiales et possède entre 5 et 75 % des réserves mondiales de minéraux essentiels à la mise en place d'une économie globale à bas carbone. Mais pour tirer parti de ce potentiel, nous devons améliorer les chaînes de valeur et abandonner le vieux modèle d’exportation de matières premières non transformées. Cela passe en priorité par la gouvernance renforcée, avec des contrats et des accords de licence plus transparents et de meilleure qualité, garantissant que la richesse en ressources du continent se traduise d’abord par une richesse pour ses propres citoyens, plutôt que par l’augmentation des profits des entreprises étrangères. Il en va de même pour nos ressources en énergies renouvelables, qui devraient être privilégiées pour d’abord mettre fin à une situation où la moitié de la population de notre continent n'a toujours pas accès à l'énergie.
Troisièmement, nous devons renforcer l’attractivité de notre continent pour les capitaux privés. Les capitaux privés, domestiques ou étrangers, sont un carburant essentiel du développement. Ils n'ont pas toujours été au rendez-vous pour diverses raisons, notamment le niveau élevé des taux d'intérêt lié au risque - réel ou perçu. On ne peut pas se contenter de blâmer les agences de notation. Là encore, nous devons améliorer notre propre gouvernance : l'État de droit, la stabilité et la transparence sont essentiels pour attirer et retenir les investisseurs. En outre, on ne peut pas plaider pour un accroissement des investissements étrangers si nous investissons nous-mêmes en priorité en dehors de notre propre continent. Le fait que seuls 14 % des investissements directs étrangers en Afrique proviennent d'investisseurs africains n'est pas acceptable.
Le déclin de l'aide ne doit donc pas être perçu comme un saut dans l’inconnu pour notre continent. L’aide n’a jamais suffi à financer le développement de l'Afrique, et la place de notre immense continent dans la nouvelle économie mondiale ne saurait être déterminée par la seule générosité des partenaires internationaux. C'est l'occasion ou jamais de repenser la manière dont nous finançons notre propre développement.
Cessons de nous focaliser sur un volume d’engagements financiers - de toute façon de moins en moins tenus – pour concentrer nos efforts sur la réforme des processus : traitement de la dette, allocation des DTS, évaluation et couverture des risques… De la part de nos partenaires, cela signifie partager le « soft power », plutôt que de distribuer des aides financières qui s'amenuisent : le partage d’expertise, de connaissances techniques, de l’information – voilà ce qui nous aidera vraiment à mobiliser nos propres ressources.
Mais avant tout, et c'est là notre responsabilité pleine et entière, renforçons gouvernance, État de droit et sécurité, sans lesquels rien de tout cela ne sera possible. Car la souveraineté implique responsabilité et redevabilité.