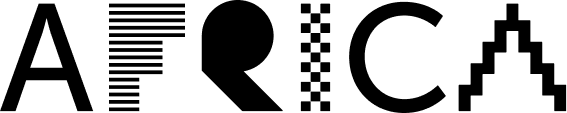Avant-propos
01 July, 2024
Avant-propos Le dernier rapport de la Banque mondiale sur les Perspectives économiques mondiales, publié le 11 juin 2024, dresse un bilan préoccupant. En 2024, la croissance mondiale devrait se stabiliser pour la première fois depuis trois ans, mais à un rythme insuffisant pour atteindre les Objectifs de développement durable. Un pays en développement sur quatre sera plus pauvre en 2024 qu’avant la pandémie. Près de la moitié des pays en développement devraient voir leur écart de revenu avec les économies développées se creuser entre 2020 et 2024, soit la proportion la plus élevée depuis les années 1990. Recette imparable pour une instabilité accrue et le durcissement des crises au sein et entre les pays.
L’«ordre mondial » mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est désormais obsolète, et le système usé. L’heure n’est plus à des plans Marshall, et il ne s’agit plus de sauver du gouffre le seul continent à cumuler guerres civiles, pauvreté endémique, catastrophes naturelles et épidémies. Le changement climatique, les pandémies, les guerres frappent partout, quel que soit le niveau de développement. Et l’Afrique est devenue un « partenaire de crise ».
Quels sont aujourd'hui les besoins de notre continent ?
En matière de développement, l’Agenda 2030 des Nations Unies comme l’Agenda 2063 de l’Union Africaine sont loin d’être réalisés, notamment en matière de santé, de sécurité alimentaire, de transformation économique et de mise en place d’institutions solides. L’évaluation des ressources nécessaires à la réalisation en temps voulu des objectifs fixés révèle un tableau complexe, mais met en exergue une conclusion commune : des restes à couvrir vertigineux, allant de 200 à 500 milliards de dollars en moyenne par an.
Le changement climatique exacerbe ces difficultés. Le continent risque d’abord un manque à gagner annuel en termes de PIB pouvant atteindre 50 milliards de dollars. De plus, principalement mené par les pays développés, dont tous les habitants ont depuis longtemps accès à l’énergie, le débat mondial sur le climat se concentre sur l’atténuation. Ce qui fait que les besoins d’adaptation, qui sont la priorité pour l’Afrique, restent largement sous-estimés. Tandis que le caractère crucial d’un accès immédiat à l’énergie pour tous est passée par pertes et profits.
Où trouver les ressources financières pour relever ces défis ?
Ce que ce rapport démontre — et je souhaite ici à remercier chaleureusement nos contributeurs externes, qui ont tous souligné ce point — c’est qu’en réalité les ressources existent, mais qu’elles sont trop souvent immobilisées ou inopérantes.
Les ressources externes d’abord.
Elles sont conséquentes, mais souvent peu accessibles et mal utilisées. L’aide publique au développement représente près de 10 % des ressources financières du continent, mais les priorités et les conditionnalités établies par les bailleurs traditionnels en réduisent l’impact. Le recours à l’endettement n’est plus une option actuellement , car la dette extérieure de l’Afrique a déjà triplé depuis 2009 et la complexification croissante de sa structure rend inefficaces les mécanismes d’allégement traditionnels. Les investissements directs étrangers en Afrique et la participation du continent aux marchés financiers mondiaux plafonnent à des niveaux négligeables.
La refonte du système financier multilatéral s’impose. Il faut accroître les ressources concessionnelles, renforcer la voix de l’Afrique dans la prise de décisions, améliorer l’agilité, la souplesse et la capacité d’innovation des institutions de prêt, actualiser les méthodes d’évaluation et de mitigation des risques africains, et mettre en œuvre effectivement tous ces engagements mondiaux qui s’accumulent.
Mais surtout, il y a les ressources domestiques.
Leur mise à profit reste encore trop largement virtuelle, car elles sont inexploitées dans le meilleur des cas ou affectées à mauvais escient dans le pire. Notre continent gaspille ses actifs.
Selon l’Union africaine, les ressources domestiques du continent devraient couvrir jusqu’à 90 % du financement nécessaire à la mise en œuvre de l’Agenda 2063. Leur mobilisation implique de tarir les flux illicites de capitaux, de renforcer et élargir les recettes fiscales— nous ne pouvons pas nous permettre d’accorder des vacances fiscales aux investisseurs étrangers —, d’investir sur notre propre continent envois de fonds, fonds souverains, fonds de pension et fortunes privées, de monétiser nos actifs verts- biodiversité, minéraux critiques, potentiel de séquestration carbone.
Le constat est clair : l’argent est là.
Nous n’avons pas besoin d’engagements en volume supplémentaires, de toute manière rarement mis en œuvre. Ce n’est pas de montants additionnels dont nous avons besoin, mais de mécanismes plus intelligents pour utiliser à bon escient les montants existants. Il faut changer de paradigme. Passer à un modèle qui concilie climat et développement. A un modèle qui dépasse les notions d’aide et de charité pour un modèle moderne assis sur la négociation et l’échange de ressources - actifs de production et marchés d’un côté, expertise, transferts de technologie, de l’autre. A un modèle qui repose sur la responsabilisation et la souveraineté de l’Afrique.